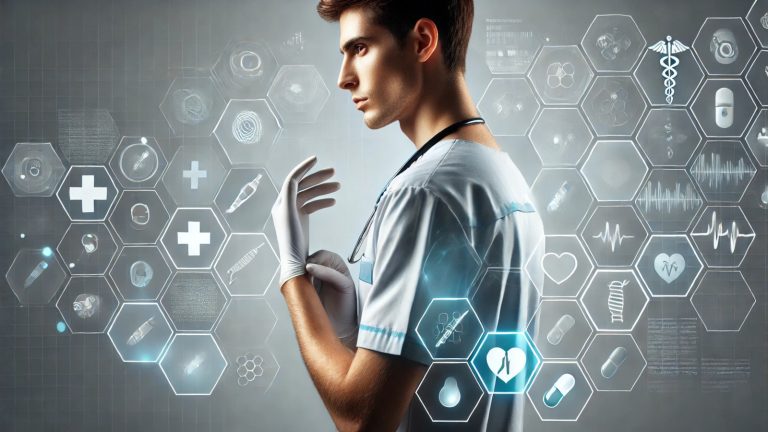Gestion des soins, recherche médicale, suivi de la situation sanitaire d’une population, les données de santé sont au cœur des traitements de l’information. Gérées par le système d’information de santé, elles enflamment aussi les débats sur la protection des données personnelles. Tout savoir sur l’hébergement des données de santé, c’est essentiel pour se conformer aux réglementations en vigueur. RGPD, directives de la CNIL, voyons dans quel cadre évolue une donnée de santé.
La définition d’une donnée de santé validée par le RGPD
Selon le Règlement européen sur la protection des données (RGPD), toute information relative à la santé physique ou mentale d’une personne constitue une donnée de santé. Il s’agit de données dites « sensibles ». Elles incluent les informations sur les antécédents médicaux, maladie en cours, traitements, etc. Ces renseignements peuvent également concerner des habitudes de vie ou des informations génétiques. Elles permettent de déduire des éléments sur l’état de santé d’un individu. C’est pourquoi elles nécessitent une protection renforcée.
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) précise que les données de santé englobent aussi bien :
- les informations recueillies lors d'une consultation médicale ;
- les informations issues de la recherche scientifique ;
- les informations issues d'un traitement par système informatique ou numérique.
Les objectifs du traitement des données de santé
Le traitement des données de santé fait référence à toute opération réalisée sur ces informations :
- collecte ;
- stockage ;
- consultation ;
- destruction.
Ce traitement doit toujours respecter les conditions qui garantissent la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Dans le cadre médical, les fuites de données peuvent avoir des conséquences graves pour la personne concernée. Les données de santé sont utilisées dans les établissements de soins pour assurer la continuité des traitements et le suivi des patients. Elles sont également essentielles pour la recherche médicale et l’innovation.
Un projet comme le système national des données de santé (SNDS) centralise des données (open data). Il a pour objectif d’améliorer la gestion de la santé publique et d’optimiser la politique sanitaire. La CNIL a autorisé Microsoft à héberger les données issues du SNDS dans le cadre de la plateforme des données de santé. Également appelée Health Data Hub, cette initiative centralise toutes ces informations pour faciliter la recherche médicale en France.
La mise en place d’un cadre légal en France et en Europe
Il existe un cadre juridique pour l’hébergement des données de santé en France bien précis. La gestion des données de santé est encadrée par plusieurs textes de loi. Le RGPD, mis en œuvre au niveau européen, est un des piliers de la protection des données. En France, la CNIL assure la surveillance des pratiques et veille à leur conformité.
Par ailleurs, la loi du 6 janvier 1978 modifiée régule l’informatique et les libertés. Cette loi définit les conditions de collecte, d’utilisation et de protection des données médicales. Elle donne ainsi un cadre légal aux établissements de santé, aux professionnels de santé et aux chercheurs qui traitent ces informations.
Les enjeux de la protection des données de santé
Les hébergeurs de données de santé jouent un rôle clé. Ils sont en effet responsables de la sécurité physique et numérique des infrastructures qui hébergent ces informations.
Choisir un hébergeur de données de santé ne se fait pas n’importe comment. La certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) atteste que les données sont hébergées dans des conditions de sécurité maximales. Ce référentiel impose des exigences aux hébergeurs en termes de gestion des accès, traçabilité, et protection des infrastructures. Ces conditions réduisent les risques de fuite de données ou d’accès non autorisés aux informations des patients. C’est pourquoi comprendre la certification HDS et la faire appliquer est primordial.
Les droits d’une personne sur ses données de santé
En vertu du RGPD et de la loi française, chacun a des droits sur ses données à caractère personnel. Les données relatives au suivi médical en font partie. Ainsi, les patients ont le droit de savoir quelles données de leur dossier médical et antécédents médicaux sont collectées à leur sujet. Et comment elles sont utilisées et à quelles fins. Ils peuvent également demander à ce que leurs données soient rectifiées, supprimées ou restituées. La loi leur accorde ainsi un contrôle total sur l’utilisation de leurs informations. Les établissements de santé sont directement responsables du traitement des données de leurs patients. À ce titre, ils doivent établir une politique de transparence et de confidentialité.
Les données de santé sont des informations particulièrement sensibles. Leur gestion doit respecter un cadre réglementaire qui garantit la sécurité et les droits du patient. Que ce soit pour les soins, la recherche médicale ou la gestion du système de santé, leur traitement doit s’inscrire dans une démarche éthique et respectueuse des libertés individuelles. Pour les établissements de santé impliqués dans la manipulation des données, se conformer aux exigences est indispensable pour protéger ces informations et inspirer confiance.
Faites appel à GPLExpert, hébergeur et infogéreur de données de santé. Notre équipe déploie un accompagnement sur mesure, en fonction de vos besoins.
Vous pourriez également être intéressé par les articles suivants :

Le cadre juridique de l’hébergement de données de santé permet d’assurer la sécurité et la protection des informations médicales. Retour sur la loi.

Comment choisir le bon hébergeur de données de santé ? Précautions d’usage pour trouver la solution d’hébergement adaptée à vos besoins.